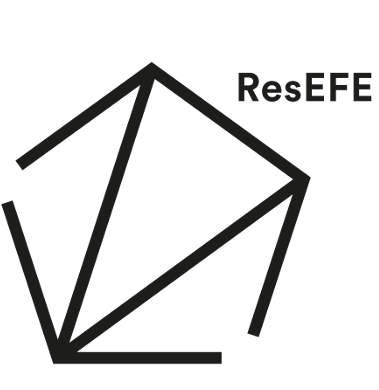Projet OLEASTRO
OLEiculture et production d’AmphoreS en Turdétanie ROmaine
Les enjeux par rapport à l’état actuel des connaissances
Entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le IVe s. ap. J.-C., la province hispanique de Bétique et son grand port fluvio-maritime Hispalis/Séville ont connu un développement économique spectaculaire marqué par l’exploitation des richesses locales que constituaient les métaux, l’oléiculture, la viticulture ainsi que les saumures et sauces de poissons (Etienne, Mayet 2001, 2002 et 2004 ; Domergue 2008 ; Le Roux 2010 ; García Vargas, Bernal 2009 ; García Vargas 1998).
Située à l’extrémité sud-occidentale de l’Empire romain, cette région fertile était, grâce à la Méditerranée et à l’Atlantique, en contact étroit avec les provinces des Gaules, des Germanies et de Britannia ainsi qu’avec l’Italie. Le commerce maritime constituait pour la Bétique une source d’enrichissement considérable, qui a largement profité à ses élites. Produit emblématique de cette prospérité, l’huile d’olive contenue en amphore était massivement diffusée dans toute la partie nord-occidentale de l’Empire, des bouches du Rhin jusqu’au mur d’Hadrien (Remesal 2011 ; Funari 1996 ; Tchernia 2011) pendant plus de trois siècles. Au sein de cette province bordant à la fois la Méditerranée mais aussi l’océan Atlantique, la Turdétanie qui correspond à la basse vallée du Guadalquivir et dont la grande richesse agricole a été vantée par Strabon, constitue la zone oléicole la plus active.
Les recherches et travaux sur sa diffusion dans l’Empire et sur l’organisation de son commerce, notamment illustrés par des centaines de marques peintes livrant les noms de 400 marchands et plus de 2 500 timbres différents (inventaire complet dans Berni Millet 2008), sont considérables et permettent aujourd’hui de bien cerner ce phénomène historique majeur (synthèse dans Etienne, Mayet 2004). A Rome, ville qui comptait un million d’habitant aux Ier et IIe s. ap. J.-C., l’huile de Bétique a constitué pendant 300 ans la principale source d’approvisionnement oléicole de la population et sa distribution était encadrée par l’état. On estime que 86 millions d’amphores Dr. 20 de Bétique ont été importés dans cette seule ville ; une partie d’entre elles formant d’ailleurs le Monte Testaccio, formidable dépotoir de 46 m de haut et de 2,2 ha de superficie situé en bordure du Tibre (Dressel 1891 et 1899 ; Rodriguez Almeida 1984 ; Remesal Rodriguez, Blazquez Martinez 2010). Ailleurs dans la partie nord-occidentale de l’Empire, les limes de Britannia et des Germanies constituaient le principal débouché de cette huile qui transitait par la vallée du Rhône puis empruntait la vallée de la Seine ou bien celle du Rhin. Dans les Gaules, la présence systématique de Dr. 20, à la ville comme à la campagne, atteste du succès de l’huile de Bétique et de la romanisation des habitudes alimentaires (Laubenheimer, Marlière 2010).

En revanche, pour ce qui concerne toute la partie amont du processus menant à l’arrivée, sur les marchés de consommation de l’huile de Bétique, le constat est bien moins positif. Dès la fin du XIXe s. sont pourtant signalés par G. Bonsor, le long du Guadalquivir et de son affluent le Genil, entre Séville et Cordoue, sur une centaine de km de long, de vastes ateliers de potiers qui livrent des grandes quantités de vestiges et en particulier des timbres sur anse qui révèlent le nom des figlinae et/ou de leurs propriétaires (Bonsor 1931).
Les recherches effectuées notamment par Michel Ponsich (Ponsich 1991), Genaro Chic Garcia (Chic García 1985 ; 2001) et plus récemment par P. Berni (2008) ont permis de recenser environ 90 ateliers de Dr. 20 et de centaines d’établissements ruraux qui produisaient essentiellement de l’huile mais aussi du vin. Il est vraisemblable que les olivettes occupaient une bonne partie des plaines et des coteaux de la vallée où le climat est particulièrement favorable à l’olivier. Les Espagnols s’étaient rendus maîtres de la taille des arbres et savaient les faire fructifier afin d’en tirer les meilleures récoltes. La main d’œuvre mobilisée pour l’entretien de ces vastes vergers et surtout pour la cueillette devait être considérable ; sans doute provenait-elle en partie du réseau très dense des villes et agglomérations secondaires, établies tous les dix à douze kilomètres.
Le Baetis/Guadalquivir et son affluent principal, le Singilis/Genil constituaient des voies d’eau idéales (Chic García 1990 ; Sillières 2001 ; Etienne, Mayet 2004, p. 151-159) pour le transport, jusqu’à Séville, d’énormes quantités d’amphores à huile destinées à la consommation de toute la moitié occidentale de l’Empire.
Pourtant, malgré l’importance de cette activité, la richesse épigraphique des amphores Dr. 20 et le nombre élevé d’ateliers, aucune investigation d’envergure n’a été menée dans cette région qui subit depuis plusieurs décennies les effets dévastateurs d’une agriculture de plus en plus mécanisée. Jean-Pierre Brun évoque dans son ouvrage sur l’archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire romain, « Une archéologie agraire ravagée » (Brun 2004, p. 282), et ce constat rejoint celui de F. Mayet et R. Etienne (Etienne, Mayet 2004, p. 147) qui insistent sur l’absence de fouille d’envergure et sur le caractère trop limité des investigations menées sur les ateliers. On pourra également, au sujet de l’indigence des données concernant les établissements oléicoles de Bétique et en particulier du bassin inférieur du Guadalquivir, se reporter à la publication récente de la thèse de Y. Pena Cervantes (Pena Cervantes 2010). Cependant, depuis quelques années, plusieurs fouilles menées en Andalousie occidentale, à Antequera, Cordoue et dans la vallée du Guadalquivir dont les résultats ont été présentés à la Table-ronde internationale de Madrid en octobre 2015, ont apporté de nouveaux éléments matériels qui mettent en avant l’importance de ces installations comportant de grandes batteries de pressoirs et de vastes bâtiments. Enfin, l’exploration de l’huilerie du IIIe s. de Las Delicias (cf. infra) a permis de démontrer le potentiel scientifique, pour l’histoire des techniques, des huileries romaines de Bétique.
En ce qui concerne le dossier des ateliers d’amphores, J. Remesal Rodriguez a effectué dans les années 1970, la fouille d’un four à La Catria (Lora del Rio) et à El Tejarillo, M.-A. Tabales Rodríguez a fouillé un atelier de potier avec cinq fours dans le banlieue de Séville (Tabales Rodriguez 2003) tandis que J.-F. de La Peña a dégagé cinq fours à Villaseca (Almodovar del Rio, Cordoue) pour lesquels on ne dispose malheureusement que d’un plan général (Etienne, Mayet 2004 p. 132-136). C’est finalement bien peu de choses par rapport aux centaines d’unités de cuisson qui, entre l’époque augustéenne et la seconde moitié du IIIe s., ont produit les amphores Dr. 20 nécessaires à la commercialisation de l’huile. L’une des conséquences directes de cette grande rareté des fouilles est aussi l’absence de toute publication de lots homogènes de rebuts d’amphores qui permettraient de mieux appréhender les questions liées à l’organisation de la production, notamment au travers de l’analyse des associations de timbres. Concernant ces derniers, il faut citer, parce qu’elles marquent une avancée fondamentale de la recherche espagnole dans ce domaine, la monographie remarquable consacrée à la Figlina Scalensia (Barea Bautista et al. 2008) ainsi que la synthèse neuve que P. Berni Millet a consacré aux différentes zones de production du Guadalquivir et du Genil (Berni Millet 2008). Enfin, la fouille de Las Delicias réalisée dans le cadre du programme PAEBR a apporté une série d’informations archéologiques et paléoenvironnementales tout à fait inédites (cf. infra).

Toutefois, si l’indigence des recherches archéologiques ne permet pas d’appréhender finement l’organisation topographique des ateliers — et donc, au moins pour les plus grands, l’existence éventuelle d’unités de production distinctes et indépendantes — le fait que chaque site livre des timbres appartenant à différents propriétaires, parfois contemporains, semble indiquer que dans bien des cas, plusieurs figlinae ont travaillé en même temps sur un même site. Une trentaine d’ateliers a d’ailleurs livré entre 10 et 90 estampilles différentes. Inversement, certains timbres relevant d’une même figlina peuvent se retrouver sur deux ateliers distincts, voire trois, parfois distants de plusieurs kilomètres. Enfin, un même propriétaire peut posséder plusieurs figlinae. C’est donc la notion même d’atelier qui semble devoir être remise en question : si figlina est l’équivalent d’atelier et si diverses figlinae coexistent sur le même site de production, on ne peut donner au terme d’atelier aucun sens topographique ou géographique comme l’a bien démontré F. Mayet (Etienne, Mayet 2004, p. 101 et 142-143). Enfin, les prospections de surface effectuées sur les lieux de production des Dr. 20 (par ex. Remesal Rodriguez et alii 1997) montrent une grande diversité de taille — les plus petits ateliers couvrent quelques centaines de m2 alors que le complexe de La Catria occupe environ 20 ha (Remesal Rodriguez 1977-1978) — et des amplitudes chronologiques diverses, souvent en relation avec leur taille, les plus petits étant ceux qui, sans surprise, fonctionnent pendant les durées les plus courtes. Il faut également rappeler la présence, sur un certain nombre de timbres originaires de sites de production essentiellement répartis entre Lora del Rio et Arva (conventus d’Hispalis), du terme port(us). Celui-ci pourrait avoir eu — comme l’avait proposé J. Remesal Rodriguez, en se basant sur l’article bien connu que M. Steinby a consacré à la question des figlinae de Rome (Steinby 1973-1974) — le sens d’horrea et l’on s’interroge sur leur statut, probablement en lien avec une fonction administrative et fiscale.
Finalement, et malgré la richesse épigraphique des Dr. 20, seules des fouilles sur plusieurs sites de production seraient susceptibles de faire avancer cette problématique du statut, des fonctions et de l’organisation des aménagements que nous avons pris l’habitude de nommer de façon imprécise « des ateliers ». Sans doute rassemblaient-ils, pour les plus importants, une grande diversité d’infrastructures économiques et commerciales.
Un autre problème est celui de l’indigence des données relatives à l’environnement : nous ne savons peu de choses de la ou des stratégies d’approvisionnement en combustible de ces ateliers d’amphores : doit-on par exemple imaginer le recours au flottage sur le Singilis, en amont d’Astigi et donc l’exploitation de zones boisées situées dans la haute vallée ? Cet approvisionnement se faisait-il dans des forêts pouvant occuper les rives de la rivière, à proximité immédiate des ateliers ou bien les zones de collines situées en retrait ? Ces espaces ont-ils été gérés de façon raisonnée, selon un modèle proche ou similaire à celui mis en œuvre à Sallèles d’Aude (Chabal, Laubenheimer 1994 ; Chabal 2001) en Gaule Narbonnaise ? Une autre piste à explorer est celle de l’utilisation de l’un des sous-produits de l’extraction de l’huile d’olive (grignons) qui jusqu’à une période récente était utilisé comme combustible pour le chauffage. Confirmée en 2014 à Las Delicias, cette piste ouvre également de belles perspectives pour préciser quelles étaient les variétés d’oliviers cultivées en Bétique dans l’Antiquité. L’enjeu est important qui permettrait de mieux comprendre dans quel processus économique se placent la création et le développement des ateliers de Dr. 20. Enfin, la question de la diminution, à partir du milieu ou du troisième quart du IIIe s., du nombre d’ateliers produisant des amphores à huile trouvera peut-être aussi un début de réponse dans l’analyse des données paléoenvironnementales.